Les fondations du lien amoureux
on est inégaux face à l'amour
Avant de commencer…
On est désormais 18,706 dans cette newsletter. Que tu sois là depuis le début, ou que tu viennes de me découvrir, merci de me lire ❤️
Pour celles & ceux que ça intéressent, voici les évènements à venir :
dimanche 27 juillet à 20h, j’anime ma dernière masterclass de l’été “Comment trouver l’amour sans les apps ni internet”. Si tu veux t’inscrire, c’est ici 👈
lundi 28 juillet à 19h15, j’anime avec Amanda Tichit l’édition #5 (et dernière avant le break estivale) de The Love Talk Show (un coaching collectif en direct). Si tu veux t’inscrire, c’est ici 👈
Personne ne nous apprend à aimer.
Enfin si. Nos parents.
Qu’ils soient présents ou absents.
Aimants ou distants.
Morts ou vivants.
Ils nous enseignent l’amour sans forcément le vouloir.
Ils sont notre première grande histoire.
Et cette histoire-là, on la rejoue souvent toute notre vie.
C’est ce que développe la psychologue Raphaële Miljkovitch dans un livre que je viens de terminer :
Les fondations du lien amoureux.
Un livre essentiel.
Pas très facile à lire, je vous préviens. Mais essentiel.
(Je l’ai lu un peu comme on lit un rapport d’enquête sur ses propres mécanismes).
L’amour n’est pas un don. C’est un héritage.
On aime comme on a été aimé.
On doute comme on a été laissé dans le doute.
On cherche comme on a manqué.
Et dans ce domaine-là, nous ne partons pas tous avec les mêmes cartes.
Certains ont grandi dans des foyers stables, sécurisants.
Ils savent exprimer leurs émotions. Avoir confiance. Se sentir dignes d’amour.
D’autres ont appris très tôt à se méfier. À séduire pour survivre. À ne pas faire trop de bruit. Et ils partent dans la vie amoureuse avec une forme de dette invisible.
Je le dis avec humilité : j’ai eu de la chance. J’ai eu d’excellents professeurs en amour — mes parents. Ce qui me permet aujourd’hui d’avoir une certaine maturité sur ce sujet. (Je précise : ce sujet. Sur d’autres, c’est beaucoup moins glorieux 😅)
Mais attention : ce n’est pas une fatalité
Ce n’est pas parce qu’on a hérité de certains schémas qu’on est condamné à les répéter.
Un héritage, ça peut se questionner. Ça peut s’analyser. Et surtout, ça peut se transformer.
Ce qui nous enferme, ce n’est pas le passé.
C’est le refus de le regarder en face.
On rejoue ce qu’on ne comprend pas.
On répète ce qu’on n’ose pas affronter.
Mais dès qu’on met de la conscience, dès qu’on ose nommer ce qui a été blessé, mal appris ou mal reçu, alors on peut réécrire le scénario.
Avec plus de lucidité, plus de liberté.
Ce que nous rejouons, sans le savoir
Une phrase m’a profondément marqué dans ce livre :
« À moins de changements notables dans ses conditions de vie, il aura tendance à transposer dans ses nouveaux liens les anticipations qu’il aura formées auprès de ses parents.. »
On croit choisir un partenaire.
Mais bien souvent, on rejoue notre histoire, dans l’espoir inconscient de la réparer.
C’est ce que Miljkovitch appelle les modèles internes.
Ils se construisent très tôt, à partir de nos premières relations affectives.
Deux modèles principaux se forment :
Le modèle de l’autre : est-ce que je peux compter sur ceux que j’aime ? Est-ce qu’ils sont disponibles, fiables, présents ?
Le modèle de soi : est-ce que je mérite d’être aimé ? Est-ce que je vaux la peine qu’on me console, qu’on me rassure, qu’on me choisisse ?
Ces modèles deviennent nos lunettes affectives.
Et ils colorent, souvent à notre insu, toutes nos relations à venir.
Quelques exemples :
Un enfant rejeté développera l’idée qu’il ne mérite pas l’amour. À l’âge adulte, il se mettra en retrait ou choisira des partenaires distants, comme pour confirmer sa croyance.
Un enfant ignoré deviendra un adulte hypervigilant, toujours à l’affût du moindre signe de désintérêt.
Un enfant surprotégé pourra vivre le moindre désaccord comme un drame, ou confondre fusion et amour.
Et tout cela se manifeste ensuite de façon très concrète :
Une jalousie incontrôlable
Une peur panique du désaccord
Un besoin de plaire ou de contrôler
Ou au contraire, un repli total pour éviter de souffrir
Ce ne sont pas des défauts.
Ce sont des stratégies de survie anciennes.
Qui n’ont simplement jamais été mises à jour.
L’histoire de L.
Je pense à une femme que j’accompagne en ce moment.
Elle a une cinquantaine d’années. Toute sa jeunesse, elle l’a passée à chercher un homme… comme son père.
Froid. Intransigeant. Autoritaire. Dur.
Elle croyait chercher l’amour.
Elle cherchait en réalité à réparer.
Et pendant des décennies, ça n’a pas marché.
Jusqu’au jour où elle a compris. Où elle a osé regarder en arrière.
Et où elle a entamé une mue.
Aujourd’hui, les relations qu’elle vit ne sont pas parfaites (spoiler : aucune relation n’est parfaite).
Mais elles sont plus justes.
Moins violentes.
Plus douces.
Parce qu’elles ne sont plus dictées par une blessure inconsciente.
Un exercice simple pour y voir plus clair
Prends un carnet. Trace deux colonnes.
Dans la première :
Ce que tu as reçu dans ton enfance
(exemples : présence, attention, critiques, distance, insécurité…)Dans la seconde :
Ce que tu recherches aujourd’hui en amour
(exemples : sécurité, admiration, fusion, liberté, réassurance…)
Puis compare. Observe les échos. Les répétitions. Les contradictions.
Et pose-toi cette question :
Est-ce que je choisis vraiment… ou est-ce que je rejoue sans le savoir ?
Ce travail n’est pas toujours agréable.
Mais il est nécessaire.
Parce qu’on peut passer une vie entière à répéter les mêmes erreurs… simplement parce qu’on n’a jamais pris le temps de comprendre d’où elles venaient.
Et non, ce n’est pas réservé à celles et ceux qui ont eu une enfance « compliquée ».
Même les histoires les plus banales peuvent laisser des traces profondes.
L’amour n’est pas un coup de chance.
Ce n’est pas une grâce qu’on reçoit.
C’est quelque chose qu’on construit.
Et qu’on peut déconstruire, aussi, quand les fondations sont bancales.
Rien n’est figé.
Mais rien ne bougera tout seul.
À bientôt,


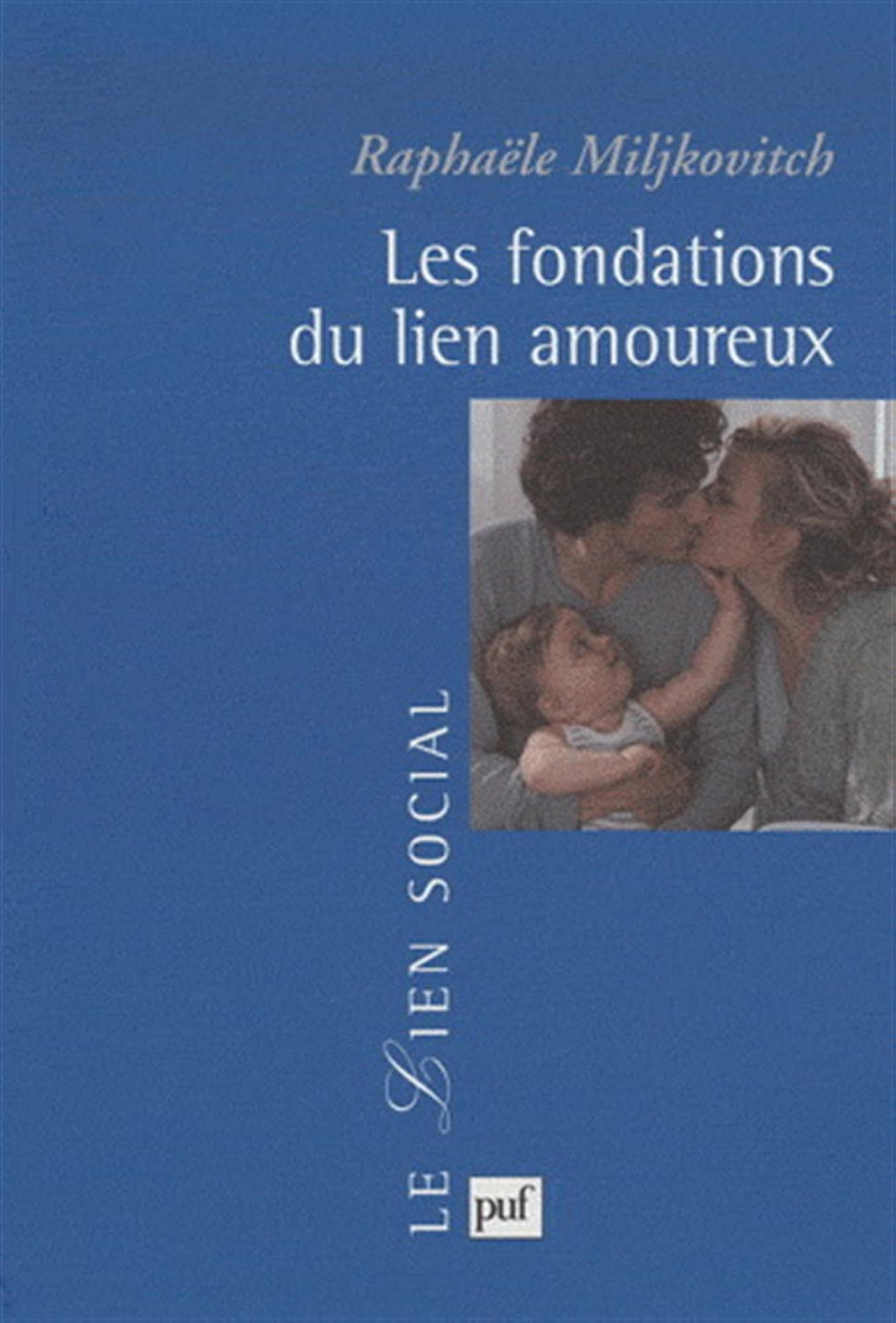
Y a t’il des hommes qui se posent autant de questions et qui veulent améliorer leur relation avec les femmes ?
Merci Antoine pour cette analyse, tout cela est très vrai.
Amicalement.
Catherine.